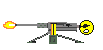Un nouvel interlocuteur vient d'entrer en jeu
Posté : 02 avr. 2010, 11:40
Depuis hier, les 26 régions de France sont officiellement dotées de leur agence régionale de santé (ARS). Inscrites au programme de la loi "Hôpital, patients, santé et territoires", les ARS "auront l'oeil aussi bien sur les comptes des hôpitaux que sur l'organisation des gardes en ville, sur le nombre de places dans les maisons de retraite médicalisées que sur les alertes sanitaires", explique Le Figaro (page 23).
Pour ce faire, poursuivent Les Echos (page 2), dix services de l'Etat et de l'assurance maladie ont été regroupés : agences régionales de l'hospitalisation (ARH), directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales (Ddass et Drass), unions régionales des caisses d'assurance maladie (Urcam), caisses régionales d'assurance maladie (Cram), hors compétences sur la retraite, ou encore missions régionales de santé.
"Plus proches du terrain, ajoute le journal économique, les ARS pourront élaborer des projets de santé répondant au mieux aux problèmes locaux. Elles signeront des contrats avec les établissements de santé. Elles pourront inciter des hôpitaux d'un même territoire à coopérer et même les y forcer si nécessaire."
C'est cette action de proximité que va par exemple devoir mener, Daniel Lenoir en tant que directeur de l'ARS du Nord-Pas-de-Calais. "Dans cette région, où les indicateurs sont souvent moins bons que la moyenne sur le cancer ou l'obésité par exemple, notre but sera de réduire les écarts", annonce l'ancien directeur général de la Mutualité Française dans Le Figaro.
Avec un budget de fonctionnement établi pour le moment à 758 millions d'euros, les 26 agences emploieront 9.200 personnes, indiquent Les Echos. La plupart d'entre elles appartenaient aux différentes administrations fusionnées. Pour les diriger, 26 "préfets de santé" ont donc été officiellement nommés mercredi en Conseil des ministres : "On trouve un ancien ministre socialiste de la Santé, Claude Evin, plusieurs préfets et sous préfet, un ancien dirigeant de cliniques privées du groupe Générale de santé, un ex-patron du groupe minier et métallurgique Eramet (...), mais très peu de gestionnaires d'hôpitaux publics", note L'Humanité (page 6).
Pour ce quotidien, "cette hyperconcentration des pouvoirs aux mains d'un ”préfet de santé” n'est pas faite pour rassurer les usagers. Car une des priorités de cette loi est le retour à l'équilibre budgétaire dans l'hôpital public". Dans le même temps, ajoute Le Figaro, certains médecins libéraux craignent que cette "étatisation" ne leur permette plus de "choisir le lieu de leur installation". Aux ARS de faire maintenant leurs preuves...
Pour info : le discours de 'RBN'
Mesdames les secrétaires d'Etat, chère Nadine Morano, chère Nora Berra,
Monsieur le secrétaire général, cher Jean-Marie Bertrand,
Mesdames et messieurs les directeurs et directeurs généraux,
Mesdames, Messieurs,
C'est avec un immense plaisir, et, je dois l'avouer, une certaine fierté également, que je m'adresse à vous aujourd'hui pour évoquer la création, effective depuis la publication du journal officiel de la République française ce matin, des agences régionales de santé.
Je ne crois pas exagéré de dire qu'il s'agit d'une journée historique pour notre système de santé.
La création, ce jour, des ARS, marque en effet l'aboutissement d'un cycle de près de 20 ans, un cycle engagé au début des années 90 par la publication d'un ouvrage au titre qui apparaît aujourd'hui presque prophétique, Santé 2010 , rédigé sous la direction de Raymond Soubie, qui évoquait, déjà, la création des ARS.
2010, nous y sommes, et il aura donc fallu près de deux décennies pour donner chair et vie à cette idée qui n'avait pourtant cessé, depuis lors, d'occuper les esprits et de nourrir les attentes.
Si l'idée des ARS s'est ainsi progressivement imposée, aux yeux de tous, comme une évidence, c'est que les ARS corrigent les deux principaux défauts de notre système de santé : sa gestion trop cloisonnée, et son excessive centralisation.
Plus précisément, le cycle historique dont les ARS sont à la fois le prolongement et l'aboutissement est marqué par trois tendances majeures.
La première est celle de la territorialisation, et plus précisément de la régionalisation de notre système de santé. Engagé dès 1977 avec la création des DRASS [les directions régionales des affaires sanitaires et sociales], ce mouvement de régionalisation s'est poursuivi, avec notamment la création des CRAM [caisses régionales d'assurance maladie], des ARH [agences régionales de l'hospitalisation] en 1996, puis s'est accéléré ces dernières années avec la création des URCAM [unions régionales des caisses d'assurance maladie], des GRSP [groupements régionaux de santé publique], des MRS [missions régionales de santé]…
La création des ARS marque ainsi la volonté, politique, de renforcer résolument le pilotage régional de notre système de santé, pour lui permettre de mener des politiques plus adaptées aux besoins et aux spécificités de chaque population, de chaque territoire.
Après la territorialisation, la deuxième tendance historique à l'origine de la création des ARS, c'est celle de la simplification et de l'unification de notre service public de la santé. La création des ARH, en 1996, en constitue l'illustration emblématique, puisque, pour la première fois, une entité unique, réunissant les forces de l'Etat et de l'Assurance maladie, a eu la charge d'un secteur entier du système de santé - et pas le moindre - l'hôpital.
Je profite d'ailleurs de cette occasion pour rendre hommage aux hommes et aux femmes qui, depuis près de 15 ans, ont porté ce projet des ARH, et qui ont, jour après jour, administré la preuve de la pertinence de ce modèle d'un acteur unique, réunissant les forces, et les cultures, de l'Etat et de l'Assurance maladie. Que l'on ne s'y trompe pas : loin de se créer contre les ARH, c'est au contraire sur leur succès que les ARS ont pu se construire, et c'est même ce succès qui les a rendues possibles.
Les ARS viennent aujourd'hui, et c'est un aspect majeur de la réforme, parachever cette simplification. Elles unifient en effet le service public régional de santé, hier encore éclaté entre plus de 10 services de l'Etat et de l'Assurance maladie. Et le terme de « service public » est ici employé dans son sens le plus noble, car les valeurs du service public sont non seulement le point commun, fondamental, ontologique même, entre l'Etat et l'Assurance maladie, mais c'est bien le service public, le service du public, le service de tous les publics, qui fonde tout le code génétique des ARS.
Je souhaite à cet égard rendre également hommage à tous les agents de l'Etat et de l'Assurance maladie qui rejoignent les ARS, chacun avec leur parcours et leur culture, mais tous avec les valeurs du service public chevillées au corps. La création des ARS a justement pour objet de créer un cadre d'action où ils pourront remplir, dans de meilleures conditions, les missions de service public qui sont les leurs.
Territorialisation, simplification, la troisième tendance historique à l'origine des ARS, et non la moindre, c'est la responsabilisation.
Responsabilisation, cela veut dire deux choses. Cela veut dire d'abord que les ARS rapprochent les décisions de l'usager et du territoire où il vit, et qu'elles renforcent significativement la démocratie sanitaire.
En participant au conseil de surveillance de l'ARS, en participant aux conférences de territoire, ou encore en participant à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, les élus locaux, les professionnels de santé, les partenaires sociaux, les usagers, qu'ils représentent les patients, les personnes âgées, ou les personnes handicapées, vont désormais pouvoir participer à la préparation et à l'évaluation de l'ensemble des politiques de santé menées en région.
Je tiens à le réaffirmer, ce droit de regard, et même ce droit d'intervention dans les politiques de santé qui appartient désormais à toutes les composantes du monde de la santé, est inédit dans l'histoire de notre pays.
Et je veux d'ailleurs dire, à ceux qui pourraient s'inquiéter de la taille des ARS, ou du risque qu'elles apparaissent comme des « boîtes noires » ou des machines bureaucratiques, qu'au-delà des textes, c'est véritablement la pratique au quotidien de l'ARS qui sera la garante de la démocratie sanitaire, et cette pratique sera fondamentalement partenariale. Pour une raison simple d'ailleurs, c'est que l'ARS peut impulser, peut coordonner, peut encadrer, mais en aucun cas elle ne peut agir seule : elle ne peut agir qu' « avec », c'est-à-dire en partenariat.
Et comme je l'ai encore rappelé récemment aux DG d'ARS : j'attache la plus grande importance à la qualité des relations – simples et fluides – des ARS avec leurs partenaires, avec tous leurs partenaires, qu'ils soient élus, usagers, médecins libéraux, ou professionnels hospitaliers ou médico-sociaux.
Mais la responsabilisation a aussi une autre signification, qui est à mes yeux tout aussi essentielle. Etre responsable, c'est répondre de son action, c'est rendre des comptes. Et le service public de la santé - peut-être plus que tout autre - doit rendre des comptes à nos concitoyens sur ce qu'il lui apporte, à la fois en termes de santé pour chacun et sur la manière dont il utilise les ressources qui lui sont confiées.
Je l'ai toujours dit, les ARS ont à cet égard une double mission : celle de mieux répondre aux besoins de santé de nos concitoyens, et celle d'utiliser au mieux les ressources que les Français consacrent à leur santé.
La santé publique, l'accès aux soins, la qualité des soins d'un côté, l'efficience de l'autre, ces deux missions étant indissociables et complémentaires. Les ARS vont ainsi contractualiser avec les ministres et s'engager sur un certain nombre d'objectifs prioritaires.
Justement, notre système de santé est confronté à des problèmes structurels, auxquels il est impératif de faire face.
* Je pense notamment au défi des inégalités de santé, et en particulier de l'accès aux soins de proximité, que seule une politique transversale de santé nous permettra de relever.
* Je pense aussi à l'importance des déficits, qui exigent que nous maîtrisions mieux la dépense, en focalisant nos efforts non pas sur les transferts de charge vers les patients-contribuables, mais sur l'amélioration de l'efficacité de la dépense.
* Je pense enfin aux exigences citoyennes, croissantes dans le domaine de la sécurité sanitaire, qui placent les pouvoirs publics devant une obligation de résultat en matière de qualité d'expertise et de réactivité.
C'est la capacité des pouvoirs publics à répondre efficacement aux besoins de santé des Français et la survie de notre modèle solidaire d'assurance maladie qui sont en jeu.
Les ARS, justement, vont y contribuer de plusieurs manières. C'est même là leur raison d'être.
En premier lieu, les ARS renforcent la lisibilité, l'unité d'action et, pour tout dire, la « force de frappe » des pouvoirs publics en matière de santé.
Je pense en particulier à la couverture des risques sanitaires. Mutualiser Les compétences, devenues parfois rares, à l'échelon régional, était indispensable pour mieux sécuriser la gestion des crises sanitaires.
Ensuite, en réunissant en une seule main les différents leviers dans le domaine de la santé, les ARS pourront mener des politiques à la fois plus pertinentes et plus efficaces.
Plus pertinentes car plus proches des réalités de terrain, plus adaptées aux besoins spécifiques de chaque territoire. Et plus pertinentes aussi car plus complémentaires. Ainsi, c'est l'action conjuguée sur différents déterminants de santé qui fait l'efficacité des politiques de santé publique.
C'est aussi en agissant sur l'offre de soins dans son ensemble que l'on peut faciliter le parcours des patients, entre le médecin de ville et l'hôpital, ou entre l'hôpital et la maison de retraite. Ce qui ressemble parfois aujourd'hui au parcours du combattant doit demain être un véritable parcours de soins, ciblé sur les besoins des personnes. Le mot d'ordre des ARS, c'est le décloisonnement, entre le préventif et le curatif, entre la ville et l'hôpital, entre le sanitaire et le médico-social. Les ARS doivent ainsi porter une vision transversale et innovante de notre système de santé.
Enfin, au-delà du rassemblement des différents secteurs de la santé, les ARS c'est aussi, secteur par secteur, une élévation du niveau d'exigence.
En particulier, les ARS sont une opportunité unique de développer la prévention et la promotion de la santé, de participer au rééquilibrage du préventif par rapport au curatif, en le plaçant au cœur de nos système de santé. A titre illustratif, la réduction de la mortalité évitable fera partie des objectifs prioritaires des ARS.
En matière de médecine de ville, les ARS devront accompagner la structuration de l'offre de soins ambulatoires, pour que les Français aient accès aux médecins là où ils en ont besoin. Elles pourront pour cela utiliser de nouveaux outils de contractualisation avec les médecins libéraux, notamment pour faciliter leurs conditions d'exercice, individuel ou pluridisciplinaire.
Sur l'hôpital, il ne s'agira plus « seulement » d'assurer l'adéquation de l'offre de soins aux besoins, en évitant les doublons. Les ARS devront piloter la performance des hôpitaux, en couvrant tout le champ allant de la qualité des soins jusqu'aux résultats financiers, en passant par l'accès aux soins et par les conditions de travail des personnels. Elles disposeront à cet effet de pouvoirs renforcés, notamment en nommant les directeurs d'hôpitaux, ou encore en contractualisant avec les établissements. En contrepartie, les directeurs généraux d'ARS seront comptables de cette performance et ils seront évalués à cette aune. Ne nous y trompons pas, le défi qui les attend est considérable.
Les exigences évoluent aussi évidemment dans le secteur médico-social, mais Nadine MORANO et Nora BERRA vous en parleront bien mieux que moi.
Mieux répondre aux besoins de santé des Français, tout en améliorant l'efficacité des dépenses de santé pour assurer la pérennité de notre modèle républicain de santé, telle est la feuille de route des ARS.
Et cette feuille de route commence dès aujourd'hui.
A très court terme, les ARS vont constituer les nouvelles instances de gouvernance territoriale : d'ici le mois de juin, le conseil de surveillance de l'ARS, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, et les commissions de coordination des politiques de santé, puis, à la rentrée, les conférences de territoires.
Elles vont également lancer, dès les prochaines semaines, les travaux préparatoires et les concertations pour l'élaboration du projet régional de santé. Celui-ci devra être adopté, dans son intégralité, au plus tard d'ici 18 mois, c'est-à-dire à la fin de l'été 2011. Les ARS établiront un diagnostic partagé, elles conduiront d'authentiques concertations et je souhaite qu'elles proposent des pistes novatrices permettant d'offrir à nos concitoyens une offre sanitaire et médico-sociale plus accessible, de qualité, et plus efficiente.
Mais j'attends aussi que, dès 2010, les ARS fassent la preuve de leur utilité auprès de nos concitoyens, qu'elles apportent des améliorations tangibles et concrètes à leurs problèmes de santé.
Je pense en particulier à la permanence des soins, qui constitue une attente très forte de nos concitoyens. Les choses sont claires : celle-ci doit être garantie, à tous nos concitoyens, sur tout le territoire, et les ARS doivent montrer une amélioration sensible dès les prochains mois. Je serai extrêmement vigilante à ce sujet.
Nos attentes et nos exigences à l'égard des ARS sont donc très élevées. Mais la contrepartie de cette élévation du niveau d'exigence, c'est qu'il faudra sans doute du temps pour que les ARS s'adaptent pleinement à leurs nouvelles missions, et qu'elles apportent toute la valeur que l'on peut attendre d'elles.
C'est donc armée d'une ardente patience que je veux aujourd'hui souhaiter longue vie aux ARS, et bonne route aux nouveaux directeurs généraux, à Claude EVIN, à Denis MORIN, à Dominique DEROUBAIX, à Daniel LENOIR, à Marie-Sophie DESAULLE, à Nicole KLEIN, à Alain GAUTRON, à Xavier CHASTEL, à Martine AOUSTIN, à Jacques LAISNE, à Jean-Yves GRALL, à Christophe JACQUINET, à Laurent HABERT, à Gilles LAGARDE, à François-Emmanuel BLANC, à Cécile COURREGES, à Pierre-Jean LANCRY, à François DUMUIS, à Jean-Christophe PAILLE, à Sylvie MANSION, à Chantal DE SINGLY, à Michel LAFORCADE, à Mireille WILLAUME, à Christian URSULET, à Dominique BLAIS, à Philippe DAMIE, et à toutes leurs équipes.
Je vous remercie.